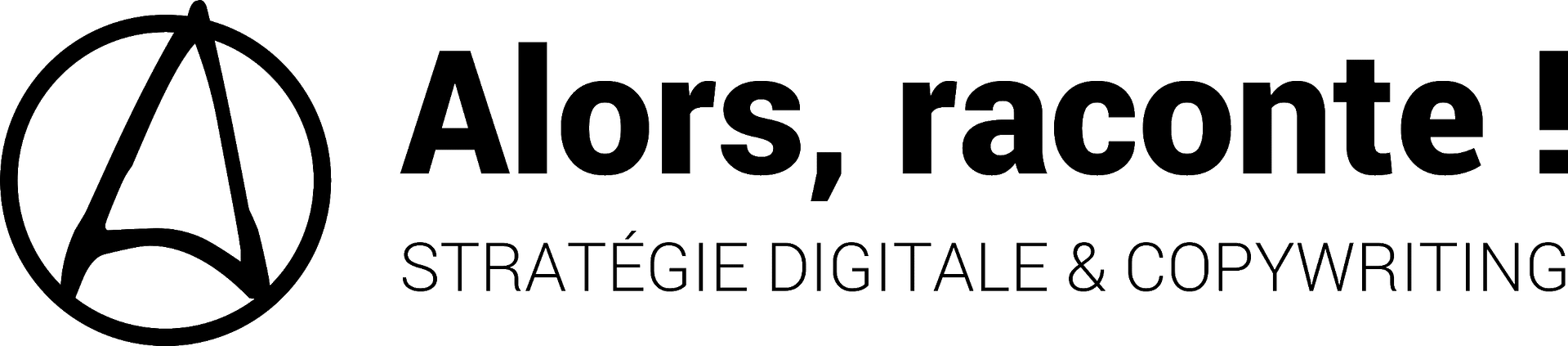Cela fait des mois déjà que l’ambiance est relativement morose dans le milieu audiovisuel. Entre une critique moribonde, des chiffres d’exploitation classique qui restent inférieurs de 25% à la période prépandémique, une succession de flops assez retentissants, et les coups de boutoir américains contre l’exception culturelle européenne. Même le discours global sur le cinéma semble être grincheux et passéiste : les films d’aujourd’hui peineraient à nous émerveiller et nous surprendre, ils s’uniformiseraient techniquement, se répèteraient thématiquement, utiliseraient tous les mêmes palettes de couleur. Même les films qui sortent des grands festivals n’ont plus l’aura qu’ils pouvaient avoir il y a encore 10 ou 15 ans.
Si bien que le discours ne semble plus se faire que sous deux registres : la consternation pour l’audiovisuel actuel et la nostalgie d’un cinéma qu’on n’arrive plus à égaler.
Ce sentiment rejoint un concept qui commence à faire de plus en plus de bruit dans le monde de la tech et par extension dans notre monde dominé par l’industrie de service : l’enshittification.
Qu’est-ce que l’enshittification ?
Ce concept théorisé en 2022 par l’écrivain et essayiste Cory Doctorow visait dans un premier temps à décrire le processus que suivent tous les grands services digitalisés que nous connaissons : Google, Meta, Uber, Amazon, AirBnb, etc etc. Dans un premier temps, ces services servent leurs utilisateurs à merveille, leur offrant quelque chose d’innovant, qui transforme leur vie de tous les jours. Ensuite, ils se mettent à vendre ces utilisateurs à d’autres entreprises, leur fournissant des informations pour en tirer un profit, notamment par la publicité. Dans le troisième temps, ils se servent des utilisateurs et de leurs entreprises clientes à leur propre profit. Dans cette phase-là, ils n’ont plus besoin d’innover, puisqu’ils sont en situation de monopole ou d’oligopole autant envers les clients que les utilisateurs. Tout ce qu’ils font, c’est ajuster leur fonctionnement pour maximiser - ou maintenir - leurs profits. Au point que l’avantage initial que ces services offraient disparaît, et qu’ils ne tablent plus que sur la captivité de leurs sources de revenus.
Jusqu’au jour où, phase finale, le coût de sortie pour les utilisateurs captifs devient moins lourd que les inconvénients, ce qui amène l’effondrement de l’entreprise, remplacée par une alternative qui recommence le processus. Cette dernière phase, il faut le reconnaître, n’a pas connu beaucoup d’occurrences jusqu’à présent - on verra ce qu’il adviendra de X.
On a tous des exemples d’enshittification en tête, du fil Instagram inutilisable à causes des pauses pub, aux recherches sur Amazon qui ne montrent quasiment plus que du contenu sponsorisé.
La question que je me pose donc aujourd’hui, pour cette dernière chronique de la saison est : est-ce ce qui est en train d’arriver à nos films et séries ? Plus qu’une simple question rhétorique, elle peut aussi résumer une bonne part des interrogations qu’on a eues pendant cette année.
Le cinéma comme service
Mais, mettons les choses au clair, la question n’est pas ici de se demander si les films et les séries, pris individuellement, sont plus mauvais que par le passé. Cela n’aurait aucun sens et ne servirait qu’à s’envoyer des listes de films au visage en guise d’arguments. L’interrogation que je vais porter ici, c’est : est-ce que le cinéma, et l’audiovisuel en général, s’est dégradé en tant que service ? Disons en tant que service culturel à la population.
En d’autres termes, est-ce que le cinéma, l’audiovisuel, en tant qu’industrie, est en train de perdre le contact avec ses utilisateurs ? Est-ce que notre industrie a cessé d’innover ?
Pour farfelue qu’elle puisse paraître, cette hypothèse nous permet de considérer le médium indépendamment de son contenu, et essayer d’aborder une approche générale de son rapport avec les spectateurs.
De ce point de vue, les choses paraissent évidentes : un point d’inflexion a été atteint au moment du Covid. C’est à ce moment-là que les changements des modes de consommation ont été accompagnés de cette vague d’insatisfaction que l’on ressent encore aujourd’hui. De la brisure - relative - dans l’économie du blockbuster à la difficile émergence de voix originales dans le cinéma d’auteur.
Et donc, si l’on suit la logique de Doctorow, l’audiovisuel, en tant qu’industrie, serait dans sa phase 3. Que ce soit dans sa version Hollywoodienne ou sa version européenne, il aurait atteint un stade où la nécessité de se renouveler, d’innover serait faible face à un public captif. Du blockbuster Marvel à la comédie française paresseuse ou au film d’auteur belge, il n’y aurait plus vraiment d’excursions significatives, de sorties de route ou de prises de risques qui nous feraient entrevoir un autre chose.
La phase 3, ou la fin de l’innovation
Une fois encore, la question n’est pas de dire qu’il n’y a plus de bons films ou séries, mais qu’il n’y a plus vraiment d’objet innovant.
Pourquoi ? Pour en revenir à Doctorow, son analyse place le problème à un niveau économique : quand un système a atteint le stade de l’oligopole, où il tient donc les clés économiques d’un segment de marché, c’est là qu’il cesse d’innover, car il cesse de se soucier de ce qui fait le socle de sa domination, son public.
On l’a vu ici, c’est bien l’un des problèmes qui ronge notre industrie. De manière différente, certes. Il n’y a pas ici une ou une petite poignée d’entreprises qui dominent le marché. Même si les Etats-Unis poussent à nouveau en ce sens. Par contre, il y a bien une structuration économique, stable et même rigide : d’un côté la machine de guerre politique, culturelle et économique Hollywoodienne dont on connaît tous le mode de fonctionnement. De l’autre, la structure européenne, faite pour sa plus grande part d’une lasagne d’aides et de soutiens à la création, d’incitants fiscaux et d’acteurs privés agissant sous obligations légales. Une structuration en guichets qui façonne, in fine, l’état d’esprit dans lequel baigne presque toute l’industrie. A savoir un éloignement de toute considération de rentabilité, de box-office. Et donc, en fait, d’intérêt pour le spectateur.
D’un côté un spectateur considéré comme une vache à lait, à qui ont peut proposer 15 films de super-héros interchangeables par an. De l’autre, un spectateur considéré comme quantité négligeable, en tout cas dans l’économie des films.
Comment sortir de la crise ?
Certes, le cinéma et l’audiovisuel ne se résument tout de même pas aux industries qui la font. Les films et les séries survivront à Netflix, à Disney, à Canal + et sans doute même à l’exception culturelle. Tout comme internet survivra à Facebook, Amazon et Youtube.
D’autant que le cinéma a connu d’autres crises du même acabit, à la fin des années ‘60 ou au début des années ‘90. Dont il s’est sorti par de l’innovation. Personne n’aurait misé sur A bout de souffle, The French Connection, ni le revival SF de la fin des années ‘90, dont Matrix a été l’emblème ultime, mais pas unique.
Il est bon de rappeler que toutes ces sorties de crises sont venues des marges : une génération de critiques pour la Nouvelle Vague, de metteurs en scène de théâtre pour le Nouvel Hollywood, de la BD et de l‘étranger (Australie, Nouvelle-Zélande, Japon) pour le rebond des années ‘90. Marges qui étaient aussi des marges économiques.
La leçon à en tirer, c’est que pour faire un cinéma différent, il faut aussi le financer différemment.
L’enshittification que décrit Doctorow est toujours une crise de business model. Pour redonner de la marge à un modèle économique qui s’essouffle, il faut donner la possibilité d’en essayer de nouveaux. Qui n’ont pas besoin d’être révolutionnaires. Juste de remettre au centre des préoccupations le socle de base : le spectateur et son besoin de nouveauté.
A cette aune-là, on a aujourd’hui assez de distance pour se rendre compte que la solution ne viendra pas de la plateformisation de l’offre, qui a plutôt été un facteur aggravant d’enshittification.
Elle ne viendra pas non plus du seul facteur économique, d’un mécène éclairé quel qu’il soit.
Elle viendra d’un rajeunissement des cadres, à Hollywood mais aussi en Europe. Et donc d’un rafraîchissement des critères de ce qui fait un film digne d’être produit.
Elle viendra aussi d’une revitalisation du discours cinéphile, qui a lui aussi joué un rôle déterminant à chaque sortie de crise : le monde des revues spécialisées pour la Nouvelle Vague, d’une nouvelle génération de critiques (Pauline Kael, Andrew Sarris) pour le Nouvel Hollywood, les bloggeurs pour Matrix et consorts. Or, on l’a vu maintes fois, le discours cinéphile est aujourd’hui en berne.
Elle viendra, enfin, d’une revigoration par des influences extérieures. Le cinéma américain a influencé la Nouvelle Vague, qui a elle-même influencé le Nouvel Hollywood, tandis que le cinéma asiatique a donné un nouveau souffle au cinéma mondial à la fin du siècle dernier. D’où viendra la nouvelle influence ? Peut-être d’un autre endroit que le cinéma.
En tous les cas, le cinéma, tout le cinéma, comme service culturel, est mûr pour une telle relance. Il est en fin de phase 3. Réfléchissons à comment enclencher la phase 4.