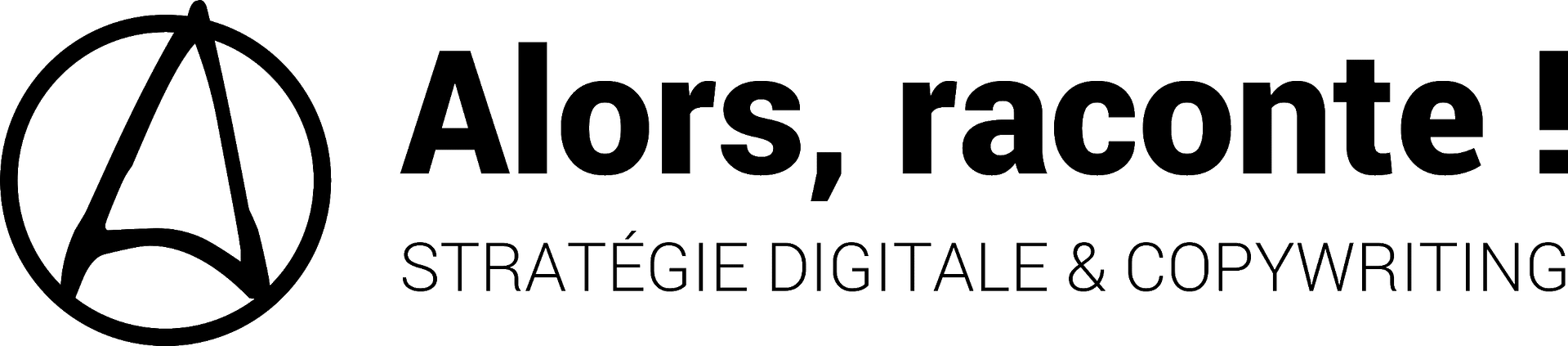Les dessous sales d’un certain cinéma d’auteur révélés par Judith Godrèche, puis d’autres actrices, n’arrête pas de faire des remous, et se révèle être, au fur et à mesure, le pendant cinéma de l‘affaire Matzneff.
Les articles et interviews qui offraient, en leur temps, une tribune à Benoit Jacquot, inondaient une jeune Judith Godrèche sous les allusions scabreuses, ou encore minimisaient sa parole, ressurgissent, semaine après semaine.
L’actrice et réalisatrice révèle elle-même des événements d’humiliation publique devant toute l’intelligentsia du cinéma français de l’époque.
Que fait la critique ?
Si bien qu’aujourd’hui, la gêne est plus que patente dans ce qui ont été les officines de la doxa critique de l’époque. Au cours des dernières semaines, trois d’entre elles, Les Cahiers du Cinéma, Télérama et Libération ont fait leur mea-culpa. Comment ont-elles pu être aussi aveugles devant les actes d’auteurs dont ils défendaient le travail : Benoît Jacquot, Jacques Doillon, Jean-Claude Brisseau, et d’autres encore.
Les Cahiers répondent à la question en postulant un dévoiement de la politique des auteurs par ses héritiers, autant cinéastes que critiques. Des hommes tellement obnubilés par la forme qu’ils pouvaient passer outre les conditions dans lesquelles cette forme était créée.
La morale. Et la morale
Sauf que cette politique des auteurs était elle-même foncièrement moralisatrice. Souvenons-nous du travelling affaire de morale de Godard, ou de cet autre travelling jugé abject par Jacques Rivette dans le film Kapo de Gillo Pontecorvo. Ce qui n’empêchait pas ces mêmes critiques de porter aux nues Hitchcock, en sachant pertinemment comment il traitait ses actrices.
Les héritiers de cette tradition critique n’en étaient pas moins moralisateurs. Les rédacteurs des Cahiers ou de Libération étaient friands d’anathèmes et de qualificatifs moraux. Et pourtant, ils pouvaient regarder sans ciller Benoît Jacquot se pavaner avec Judith Godrèche, 14 ans, lors de dîners dans des festivals prestigieux.
De quel aveuglement parle-t-on, en fait ? Comment ces gens, qui pouvaient être bouleversés jusqu’à en vomir devant un film pourtant très théorique de Godard (Ici et Ailleurs), restaient-ils insensibles devant une jeune fille qu’on fait boire jusqu’à, elle aussi, en vomir ? Quelle distorsion de la réalité donne plus d’importance à la forme qu’à celles et ceux qui les font ?
Un aveuglement générationnel ?
Et surtout, cet aveuglement est-il vraiment passé ? Parle-t-on vraiment d’une génération disparue ?
Pour se faire une idée, il faut déjà se rappeler d’une autre affaire, celle de Jean-Claude Brisseau. Bien plus proche de nous, 2006, elle a suscité à l’époque une même levée de boucliers d’une certaine intelligentsia critique, qui ne supportait pas de voir le grand geste artistique de l’auteur se faire ainsi rappeler à l’ordre par la justice.
13 ans plus tard, à la mort de l’auteur, tout le monde semble avoir changé d’opinion. Et il n’y a presque plus personne pour rendre hommage au cinéaste, qui a pourtant réalisé des films encensés en leur temps. Changement d’époque ?
Pas si vite. Dans l’intervalle, en 2015, Benoît Jacquot pouvait encore assez librement dire dans les colonnes de Libération que, pour travailler correctement avec une actrice, le mieux était encore de la mettre dans son lit.
2015, ce n’est pas la fin des années ‘80. On ne peut même pas parler de saut d’une génération critique. Et, si aveuglement il y a eu, rien ne garantit que l’affaire qui secoue le petit milieu du cinéma français aujourd’hui lèvera l’entièreté du problème.
La parité ne suffit pas
Car, dans leur mea-culpa, critiques et patrons de festivals répondent tous quand même un peu à côté, en disant que tout cela n’est maintenant plus possible parce qu’il y a la parité dans les rédactions, et dans la composition des programmations.
Comme si tout cela n’était qu’une question de regard masculin ou féminin. Comme si tout cela n’était pas d’abord une question de pouvoir symbolique. De la part des cinéastes, mais aussi des critiques. Un pouvoir pour lequel il n’y a pas vraiment de problèmes à voir le corps, l’intégrité physique de l’autre, comme un pur objet.
Et ça, ce n’est pas vraiment quelque-chose qui change. Peut-être ne se permettra-t-on plus de voir et de montrer les femmes, et surtout les jeunes femmes, comme de purs objets de désir. Mais ça ne veut pas dire que l’objectification aura totalement disparu.
Changer de regard
Pour prendre un exemple dans l’immédiate actualité, il suffit de voir les discours autour de la cinématographie de Bruno Dumont, dont le dernier film, l’Empire, vient de sortir.
La manière dont le discours critique réduit ses acteurs amateurs à de purs corps, tandis que les acteurs professionnels sont dans le jeu, perdure depuis le début de la filmographie de l’auteur. Auteur qui a beau réfuter cette distinction à longueur d’interviews - malgré une certaine misanthropie assumée - mais rien n’y fait. Le pauvre, le bas peuple, le prolo n’est qu’un corps. Et Dumont, qui s’en défend tout autant, est vu comme un marionnettiste de génie.
C’est d’abord ce regard-là, ce regard bourgeois sur le cinéma, qu’il faut questionner si on ne veut pas passer à côté de l’ampleur des interrogations que Judith Godrèche et tant d’autres femmes - et aujourd’hui d’hommes - mettent sur la table.
Et dans l’état actuel des choses, malgré les professions de foi des critiques et des autres dans l’immédiate suite de la dernière cérémonie des César, cette remise en question-là n’est pas à l’ordre du jour.