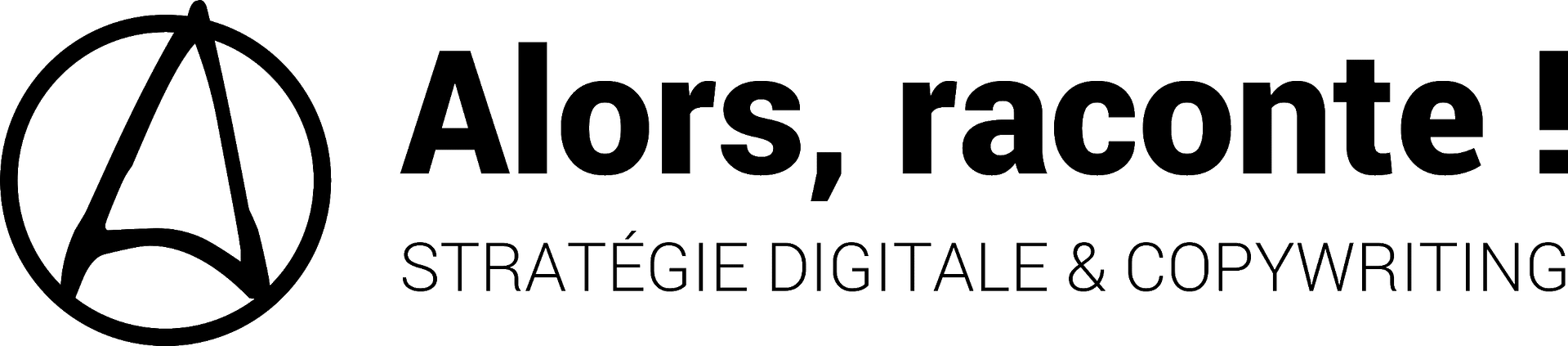Si elle dure jusqu’à la fin de ce mois de septembre, la grève des scénaristes et acteurs de Hollywood deviendra la plus longue que le secteur ait jamais connue aux Etats-Unis. A l’heure d’écrire ces lignes, rien ne laisse présager d’une résolution rapide. Mais les négociations sont évidemment secrètes, et la dramatisation, toujours à son comble, fait partie du processus de ce genre de discussions.
On le sait, la combat que mènent les travailleurs et travailleuses de Hollywood est on ne peut plus légitime. Comme c’est le cas tous les 15 ans, dès qu’une nouvelle technologie de diffusion d’oeuvres audiovisuelles fait son apparition, leurs syndicats doivent systématiquement se battre pour que leurs droits à une juste rémunération soient respectés.
Car en fait, et ça on le sait un peu moins, le syndicalisme est très puissant aux Etats-Unis, en tout cas dans certains secteurs d’activité. Le conflit social y est souvent plus intense, moins policé que dans certains pays d’Europe, comme le nôtre, ou comme l’Allemagne.
Détour historique
Si bien que chez nous, où le secteur est, qui plus est, beaucoup plus petit en termes de travailleurs impliqués, on a peu de chances de voir un conflit de cette ampleur. Le dernier en date à ma connaissance est celui des intermittents du spectacle en France, et il ne concernait pas que le cinéma.
Il y a quelques jours, le Youtubeur Bolchegeek, sortait une nouvelle vidéo sur le conflit Hollywoodien. Si son nom de Youtubeur ne vous a pas mis sur la piste, sachez que cette vidéo a été postée sur le compte du journal l’Humanité. Son point de vue est donc, on s’en doute, celui de la gauche syndicale. Point de vue qu’on appelle aujourd’hui Gauche Radicale, Ultra-Gauche, ou lézextrèmes. Et qu’on appelait dans ma jeunesse la social-démocratie. C’est vous dire à quel point je deviens vieux.
Au détour de sa vidéo, Bolchegeek rappelle rapidement que dans les années 1930, Hollywood et la Californie étaient bien plus radicales que cela encore. Le candidat démocrate de l’Etat, l’écrivain Upton Sinclair, prônait carrément lors de sa campagne l’autogestion ouvrière des studios d’Hollywood. Rien que ça. Et cela a donné lieu à la première campagne de propagande politique des Etats-Unis, avec des sommes faramineuses dépensées pour décrédibiliser Sinclair.
L’autogestion ouvrière des studios.
Voilà qui aurait radicalement changé la face du cinéma, et probablement du monde. Un cinéma sans patrons, sans conflits récurrents, sans conventions collectives à renégocier en permanence pour s’assurer une rémunération juste du travail par rapport au capital.
Rappelons qu’à cette époque, tous les travailleurs, du scénariste aux acteurs et aux techniciens, étaient rémunérés à l’année par les studios. En bref, Sinclair proposait l’utopie de salariés libres.
A la recherche du salarié libre
Est-ce qu’une telle utopie est seulement possible ?
A l’heure actuelle, la réponse est simple : non. Légalement, dans nos pays occidentaux, un salarié libre est une contradiction dans les termes.
Pour être salarié, il faut un patron. Et il faut que le salarié abandonne la souveraineté de son travail au patron. Il est son subordonné. C’est la loi.
Si ce salarié veut être libre, il doit prendre le statut d’indépendant, et renoncer donc à la protection sociale qui correspond au statut de salarié.
C’est une chose que je n’ai moi-même apprise qu’il y a à peine deux ans, lorsque nous avons voulu engager notre première salariée dans notre petite entreprise de production. Le résultat de plus de deux cents ans de lutte des ouvriers et ouvrières n’appartient qu’à celles et ceux qui acceptent d’abandonner leur liberté, selon le vieil adage bourgeois, et féodal, et impérial avant lui, de la liberté contre la sécurité.
Mais, me direz-vous, il suffit de contourner la loi, et de se doter d’un faux patron. Sauf que ce n’est que l’autre face de la même pièce. Car le faux patron, dans ce cas, se doit d’être un travailleur indépendant, et de porter, seul, aux yeux de la loi, la responsabilité collective. Il est à la merci du respect de la fiction par tous les travailleurs dont il est le faux patron. C’est donc lui, de facto, et sans contrat pour le coup, qui devient le subordonné de tous les autres travailleurs.
Retour à la réalité
Pourquoi je vous parle de tout cela ? Pourquoi cette envolée lyrique sur le piège du salariat ?
C’est que, au plus je m’avance dans la réflexion que je tente d’avoir avec vous à travers ces chroniques, au plus je bute sur les mêmes problématiques.
Ces questions sont simples : une autre manière de faire du cinéma est-elle possible ? Pourquoi la Belgique francophone est-elle incapable d’avoir une vraie industrie audiovisuelle, diversifiée ? Pourquoi n’avons nous pas de cinéma populaire ?
La réponse, à mon sens, tient en un concept, de plus en plus inaudible au fil des années : l’ordre bourgeois.
Et quand je dis cela, ce n’est pas pour me placer dans une perspective socialiste ou communiste.
Ce que je veux dire par là, c’est que toutes ces questions sont conditionnées par une logique de méfiance généralisée et de lutte pour la domination, financière, sociale et culturelle. Cette logique n’est pas que l’apanage des patrons, elle est aussi celui des travailleurs.
Marche ou grève
Pour reprendre l’exemple de la lutte syndicale à Hollywood. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun syndicaliste de renverser la table. Ils ne veulent plus, comme du temps de Sinclair, se passer de patron. Ils veulent juste gagner les négociations.
De même, si nous n’avons pas de cinéma populaire, ce n’est pas (uniquement) la faute des méchants producteurs. Il n’y a pour ainsi dire aucun scénariste et encore moins de réalisateur, qui accepterait de faire quelque-chose comme Familie ou Plus belle la vie. Alors ne pensons même pas à un film comme Les Tuche. Ce qui est populaire est vulgaire. Si on doit faire de la comédie en Belgique francophone, ce sera du Toledano et Nakache, ou du Hazanavicius. Pas du Olivier Baroux.
Changer les conditions de travail du cinéma ne peut aujourd’hui se faire que dans un cadre dicté par une logique d’opposition inscrite dans la loi. Et cette loi, quelle que soit la manière dont on cherche à la décrire, découle d’un ordre bourgeois, où le travail est subordonné au capital. Où un travailleur doit obéir à un patron.
Nawell Madani et les mauvais patrons
Il y a quelques jours, Mediapart publiait un article révélant les conditions de travail pour le moins difficiles sur le tournage d’une série Netflix réalisée par Nawell Madani, Jusqu’ici tout va bien. Effectivement, à sa lecture, difficile de dire que ce tournage n’est pas problématique. Tensions, problèmes de sécurité, départ de techniciens,…
A la suite de cet article, un technicien de cinéma réagissait à ce qu’il a lu, portant ses accusations sur trois personnes. Nawell Madani elle-même, qui effectivement portait peut-être un peu trop de casquettes sur ce plateau, et semblait être autoritaire. La société de production Elephant, qui produit des formats télévisuels et des fictions depuis 20 ans, et dont le technicien pointe sans oser l’assumer la médiocrité, expliquant ainsi implicitement l’incompétence qu’il lui reproche. Et Netflix, complètement négligente de son point de vue, puisqu’un référent a été dépêché sur le plateau, sans prendre de décisions.
La faute aux patrons, donc, sous toutes leurs formes. Quoi de plus normal.
Ce qui m’étonne dans cette affaire est pourtant d’un tout autre ordre. Le tournage a eu lieu en 2022, sur une période de 10 mois, et avec 70 jours de tournage. La série est diffusée sur Netflix depuis avril 2023, avec une campagne de promo et des tournées d’interviews conséquentes à l’époque.
Mais ce n’est pourtant qu’en septembre 2023 que sort l’article de Mediapart. Plus d’un an et demi après les premiers faits problématiques. Et tous les témoignages sont anonymes.
La chasse au responsable
La question que je me pose est : d’où vient ce silence ? Pourquoi personne ne canne devant des faits qui, de l’aveu des témoins, les ont traumatisés ?
Ma réponse, et elle n’engage que moi : la hiérarchie.
Non seulement personne n’ose parler, de peur de ne plus être engagé sur d’autres plateaux. Mais surtout on s’attend à ce que l’autre, le responsable, le supérieur, réagisse, prenne la responsabilité. C’est d’ailleurs ce que souligne en permanence le technicien, en faisant sans cesse référence aux chefs de poste, aux directeurs de ceci ou de cela, au référent Netflix.
Il n’empêche, à un moment donné, un ingénieur du son est monté dans une voiture conduite par une actrice qui n’a pas le permis, sur une route qui n’était pas fermée à la circulation. Pourquoi n’a-t-il pas tout simplement refusé ? Dans quel état de subordination peut-il être pour mettre sa vie en danger ? Idem pour la conductrice, par ailleurs. Tout cela pour le tournage d’une scène d’une série ? Tout cela pour du cinéma ?
Comme toujours dans pareil cas, le technicien auteur de la vidéo donne plutôt des solutions techniques : on aurait dû mettre la voiture sur un camion. Dépenser encore plus d’argent. De toute façon, les patrons en ont les moyens.
Mais il ne lui viendrait pas à l’esprit que la première solution, c’est de refuser de tourner la scène, et de la réécrire, pour s’adapter aux circonstances ?
Comment en arrive-t-on là ?
On apprend même dans la vidéo du technicien que Netflix a mis en place une hotline pour alerter des faits problématiques. Et que cette hotline a, dans le cas de cette série, été utilisée.
Comment en arrive-t-on à préférer passer par un système d’accusation anonyme que par une confrontation directe ?
Eh bien de la même manière que nous n’arrivons pas à éradiquer le harcèlement moral et sexuel des plateaux : parce qu’on y laisse y proliférer le pouvoir. Il faut des chefs, et il faut des patrons, auprès desquels les travailleurs et travailleuses pourront aller se plaindre en invoquant les conventions collectives et les codes du travail. Parce que, sans ces conventions, et sans ce code, les travailleurs ne peuvent tout simplement pas dire non.
Le truc, ce n’est pas seulement de se passer de patron. C’est aussi de se passer de toute l’idéologie qui l’entoure. Qui est en nous, patrons comme employés. Et qui ne nous font envisager les relations de travail que comme asymétriques, conflictuelles.
Alors bien sûr, j’ai bien conscience de l’aspect boy-scout de ce que je suis en train de dire. Si tous les gens de bonne volonté pouvaient se donner la main, tout ça.
Mais je préfère voir les choses d’un autre point de vue. Sans doute pour me cacher ma propre naïveté. C’est le point de vue de l’anthropologue David Graeber, quand on lui demandait de définir ce que c’est qu’être anarchiste.
Un anarchiste, disait-il, c’est celui qui, en toute circonstance, agit comme si il était déjà libre.