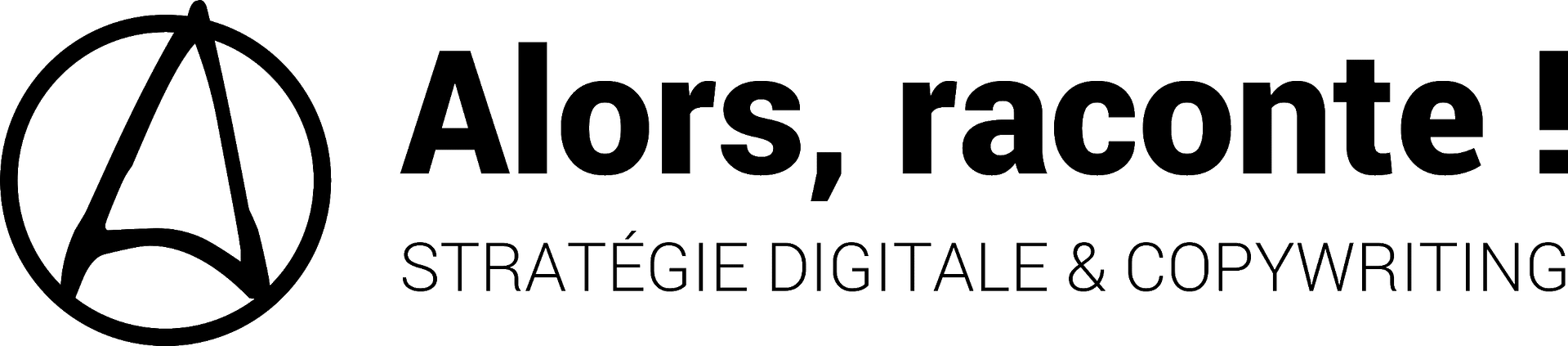Nous avions commencé cette quatrième saison avec le cri d’alarme de la presse internationale à Venise, et une interrogation sur l’avenir de la presse ciné, et même culturelle en général.
Cette fin de saison vient apporter de nouvelles péripéties à cette interrogation.
Le wokisme contre-attaque
A tout seigneur tout honneur, commençons par la polémique qui a secoué les réseaux sociaux, de Bluesky à Linkedin en passant par le brontosaure Facebook, en tout cas dans le microcosme belge francophone : l’annonce de l’arrêt de l’émission radiophonique “5 Heures”. Cette vénérable institution, qui venait de fêter ses 30 ans, vit donc ses dernières heures, et c’est toute une génération - la mienne - qui brâme avec son producteur Rudy Leonet sur cette décision inique.
C’est que Rudy Leonet n’a pas manqué de sortir l’argumentaire de Patrick Sebastien pour annoncer la nouvelle : ce serait bien le wokisme qui chasserait les vieux mâles blancs cisgenres des antennes. Couplé à un populisme mal dégrossi, qui n’apprécierait pas la critique d’objets culturels pointus.
Sauf que, malheureusement, la réalité est bien plus prosaïque que cela. Tout d’abord, et parce que je suis assez vieux pour l’avoir connu, les critiques sur la distinction bourgeoise des deux acolytes date des débuts de l’émission. Et on n’a pas attendu le wokisme pour entendre des critiques récurrentes sur ces deux hommes blancs gloussant sur la kitscherie de la culture populaire pour mieux encenser la bonne et respectable culture, forcément pointue, et si possible anglo-saxonne.
D’autant que ce sont bien les anti-woke qui ont eu la peau des “5 heures” : ceux-là même qui imposent au repaire rouge de la RTBF des économies. Economies qui, comme partout, frappent d’abord les indépendants, virables d’une simple cessation d’émission. Et plus encore les indépendants qui coûtent le plus cher : les plus âgés. C’est aussi simple qu’un programme libéral.
Lente élimination
Mais l’émission des duettistes n’est pas la seule sur le billot. Même si cela se fait sans le ramdam qu’on vient d’évoquer, le fusion des 2 plus grands groupes de presse belges - Rossel et IPM - annonce aussi déjà sa petite hécatombe chez les pigistes, et principalement les pigistes culturels. Les rumeurs ne font pour l’instant que circuler dans la profession, mais ce ne serait que la suite d’une longue liste de restructurations dans le secteur.
On savait déjà la profession largement précarisée. La voilà doucement éliminée.
Et le phénomène n’est pas que belge, puisque la France a elle aussi eu droit à son psychodrame, avec la menace de l’arrêt de l’émission Le Cercle, sur Canal +, la dernière émission entièrement consacrée au cinéma de la télévision. Si l’émission survit finalement (en tout cas pour l’instant), l’émoi autour de cette possible suppression a été l’occasion de ressentir la grande fébrilité du milieu critique français.
Comme je le disais déjà au début de la saison, la question de cette survie de la critique est bien sûr une question de modèle économique.
Mais ces derniers événements amènent une nouvelle question : et si c’était plutôt une certaine forme de critique, un certain type de discours sur le cinéma qui était en train de disparaître ? Cette forme, ce serait celle qu’on pourrait appeler la critique prescriptive. A savoir, une critique qui nous dirait, du haut d’une autorité, quelle qu’elle soit, ce qu’il y a lieu de voir ou de ne pas voir. Ce qui est bon et ce qui ne l’est pas.
Déclin de la critique prescriptive
Cette critique-là, qui est celle qu’on a toujours connue, n’est peut-être tout simplement plus en phase avec l’état actuel de l’audiovisuel. C’est une critique qui correspond à une offre certes abondante, mais néanmoins définie. C’est celle des salles de cinéma, voire des chaînes de télévision à l’ancienne.
Une critique où il fallait choisir entre 5 à 10 films par semaine celui - ou les 2 ou 3 - qui valait vraiment le coup.
Si ce n’est qu’aujourd’hui, l’offre n’est pas seulement pléthorique, elle se présente de plus en plus en silos - c’est d’ailleurs ce qui a valu la fameuse polémique au BIFFF il y a deux ans. L’offre totale s’est hyper-spécialisée. Et pas seulement à cause des plateformes : les cinémas, les festivals, les rétrospectives, les événements, sont tous devenus de niche. Et je ne parle ici que de l’offre audiovisuelle, mais la même chose vaut pour la musique, le jeu vidéo, sans doute la littérature : il n’y a plus, sauf à quelques exceptions près, d’audience globale à qui s’adresser.
Ajoutez à cela la complexité propre à chaque individu, susceptible d’aimer à la fois le cinéma tchèque des années ‘70, l’EDM, et le jeu vidéo indépendant, et l’on en vient à se poser cette question : de quel endroit culturel un critique de cinéma peut-il aujourd’hui assénert son discours ? Celles qui regardent Love Lies Bleeding peuvent elles encore parler celui qui regarde Happy Gilmore 2 ou K-Pop Vampire Hunter sur Netflix ? Est-ce qu’un fan de Marvel peut encore dialoguer avec un cinéphile scorcésien ? Est-ce qu’un rat de cinémathèque peut encore comprendre l’engouement pour les documentaires true-crime ?
Comment “faire culture” ?
La critique de cinéma prescriptive est une forme de discours qui présuppose qu’il existe encore une forme de communauté. Et on peut très légitimement se poser la question de savoir si ce n’est pas là le coeur de la crise de la critique - et pour les plus pessimistes, de la crise de notre civilisation - l’amenuisement de l’expérience commune. Le but de la critique prescriptive est, en quelque sorte, de faire culture. Dans notre monde à la culture éclatée, il est peut-être tout simplement devenu obsolète.
Dans ce monde-là, la prescription a changé de forme. Elle est dans les réseaux sociaux, spécialisés comme Letterboxd ou Senscritique, ou généralistes, sur X, Instagram ou Youtube. Ou encore sur les sites d’agrégation comme Allociné, et même sur Google. Dans cet univers rempli de pouces levés et baissés, où la cotation de tout, et donc aussi des films et séries, se fait là aussi d’un simple coup de pouce. Dans cette économie, les “thumbs up” ou “down” des critiques ne sont plus qu’un avis parmi tant d’autres.
Ne leur reste alors que l’autorité et la faible valeur commerciale qu’elle a encore, sur les campagnes d’affichage paresseuses, où leur avis est réduit à un adjectif enjôleur. Au point qu’on peut se demander si cette presse critique n’a plus, au fond, que ce rôle : nourrir à moindres frais la campagne promotionnelle des distributeurs. Et celui, concédons-le, d’attirer un public toujours plus vieillissant.
Vers une nouvelle critique ?
Mais, une fois ce constat posé, quelles lignes en tirer ? Y a -t-il encore une place pour d’autres formes de discours critique ? Pour un discours analytique par exemple ? Ou politique ?
Plus profondément, y a-t-il encore une place aujourd’hui pour des médias culturels? Qu’ils soient à l’ancienne, aujourd’hui plus outils de prestige dans le catalogue d’acquisitions de milliardaires comme Les Inrocks , ou suppléments de magazines eux-mêmes à la peine, comme Focus Vif. Quand ce ne sont pas des organes au bord de la faillite comme Première. Ou qu’ils soient - plus tellement - nouveaux comme les sites ou les chaînes Youtube ?
En d’autres termes, y a-t-il encore moyen, aujourd’hui, de faire communauté autour de la culture ? Et si c’est le cas, sous quelle forme ?
C’est qu’on voit poindre, à l’horizon, une nouvelle forme de structuration de la presse en général. Celle-ci se réunit - à nouveau - autour de marques, d’identités, de marquages forts. Des marquages surtout politiques, comme au temps de la presse triomphante - qui était d’ailleurs le temps d’une critique triomphante.
Ce sont ces marques, ces identités, qui attirent vers elles des collaborateurs, épisodiques ou non, ayant acquis leur notoriété ailleurs. On pense à Blast et Mediapart en France, attirant Youtubeurs, essayistes, comiques, dans des formats hybrides, en vidéo, en podcast ou par écrit. Mais la même chose se passe à droite, voire à l’extrême droite. Ou dans des silos bien particuliers. On songe là à un média comme Médor, ou à la résurrection de Metal Hurlant.
L’ère des déchiffreurs
C’est peut-être ça, l’avenir d’un média culturel : être un agrégateur de talents connus par ailleurs, parfois pour tout autre chose. Une marque capable d’attirer à elle les discours destinés à un certain type d’audience. Et ces talents, ces voix, ne seraient plus là pour prescrire, mais pour comprendre. Non plus dire ce qui doit être vu, lu, entendu. Ne plus se poser en découvreur des nouvelles tendances. Tout cela n’a sans doute plus de sens aujourd’hui. Juste tenter de mettre du sens en plus dans ce qui peut sembler déroutant, aider son audience à appréhender des oeuvres, des mouvements.
Ne plus être défricheur, mais déchiffreur.
Comprendre que nous ne sommes plus dans un monde d’élection, où l’on élèverait certains films, certains auteurs suivant des critères d’autorité. Mais dans un monde d’émergence, où des vagues se créent dans une surabondance de l’offre. Où le but de la critique est de se laisser porter par la vague et comprendre son mouvement. Puis de partager cette compréhension. Voire de repêcher dans le passé ce qui nous permettrait de mieux comprendre aujourd’hui.
Cela veut dire aussi que le mode d’organisation rédactionnel doit être revu. Dans un modèle d’agrégation, la structuration hiérarchique ne peut pas fonctionner de la même manière. Le travail se devra d’être plus collégial, de laisser place à la surprise. Et donc être multi-formats. Plus vraiment de rédaction en chef, mais une coordination des contenus.
Quel modèle économique ?
Mais il reste néanmoins la question d’origine : quel modèle économique pour une telle presse ?
Là aussi, le modèle qui semble émerger est le modèle coopératif. La plupart des médias de ce nouveau modèle adoptent un format de financement hybride, entre donateurs (institutionnels et particuliers), abonnements, et participation au capital. Ce qui implique, là encore, de réussir à faire communauté. A savoir véhiculer des valeurs identifiables, et qui donnent envie de s’y identifier. Il est déjà clair qu’il faudra être plus large que la pure verticalité comme par exemple l’analyse via les théories du genre. Des tentatives ont déjà été tentées en ce sens et se sont révélées des échecs. Mais alors, où trouver la bonne équation, la bonne distance entre le généraliste et le communautaire ? Est-ce que la culture elle-même est encore un silo suffisant pour y creuser des approches particulières économiquement viables ?
Vaste chantier pour qui voudrait le prendre à bras-le-corps. Mais c’est peut-être là qu’est la voie de sortie à la morosité de tout un secteur qui n’arrive toujours pas à se renouveler.